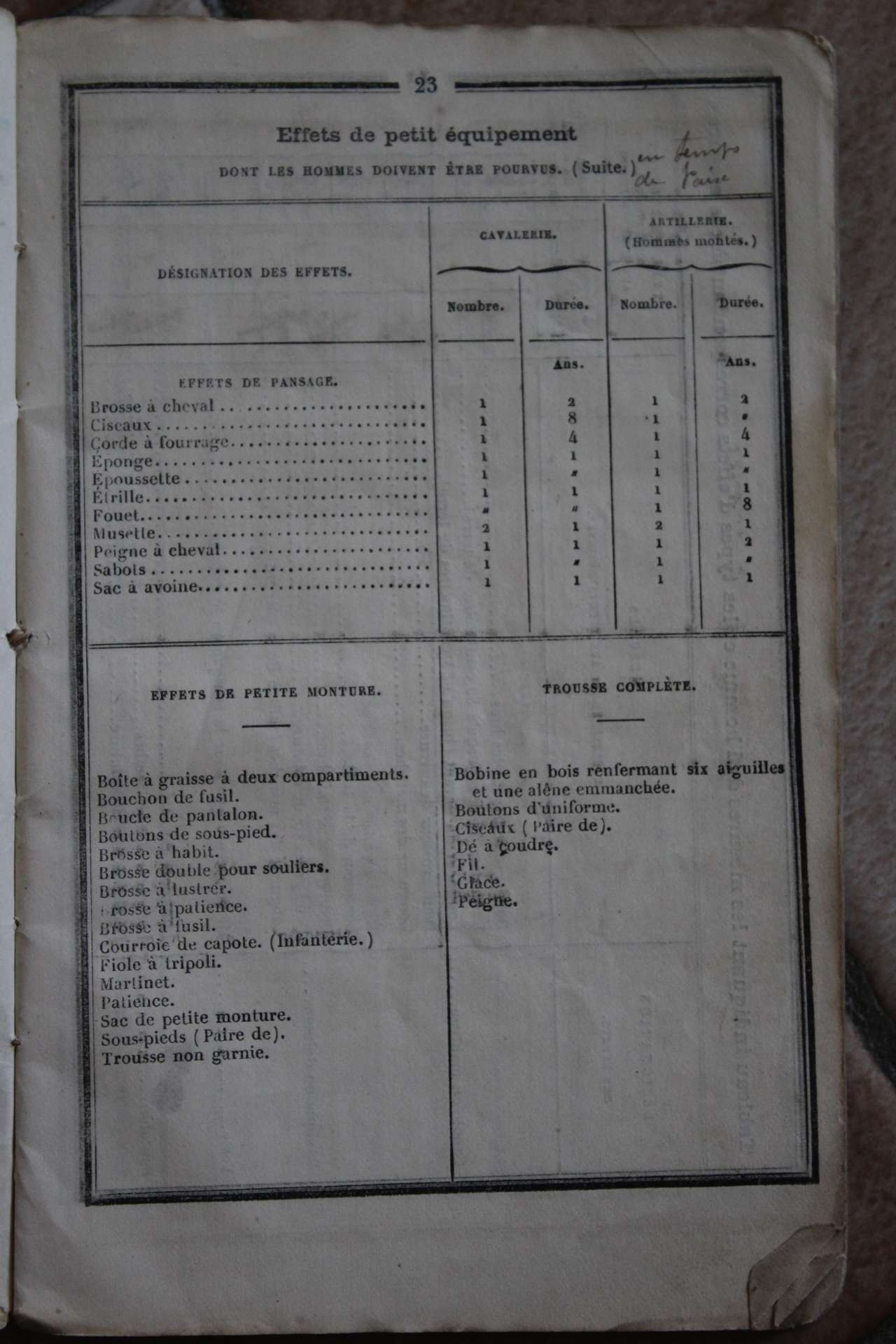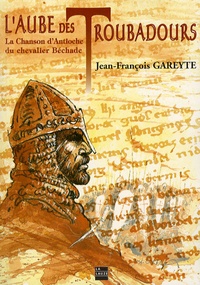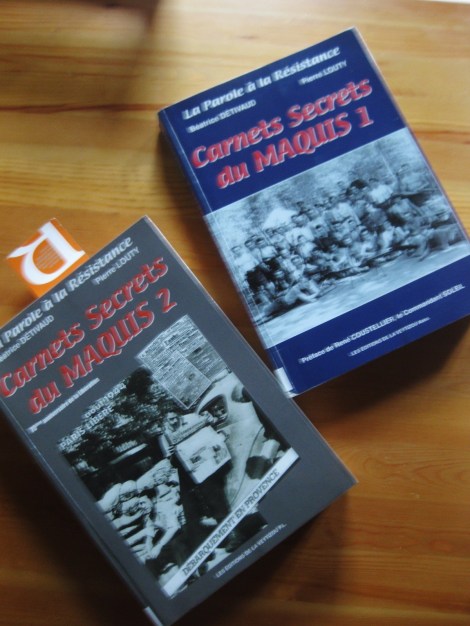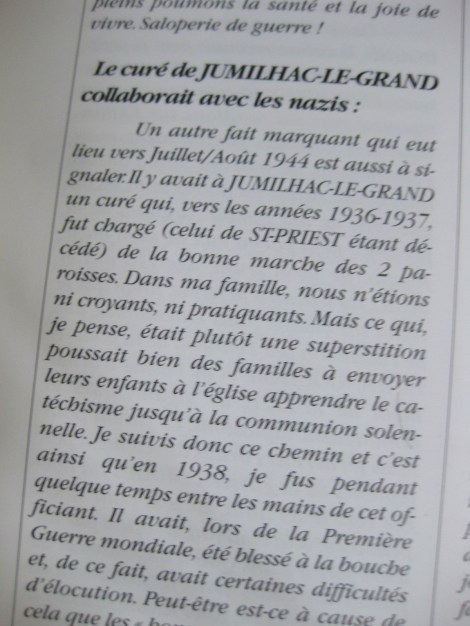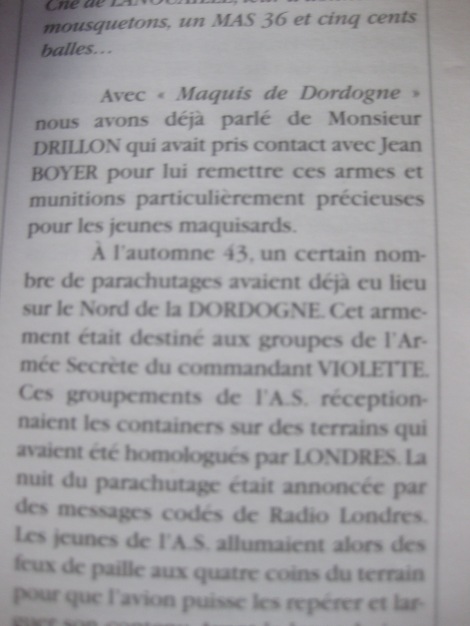En 1686, la fistule anale de Louis XIV donne naissance à l'hymne britannique.
"Les Souvenirs apocryphes de la marquise de Créquy rapportent que l'air Seigneur (Dieu), sauve Le Roi a été composé par Jean-Baptiste Lully sur un texte écrit par la duchesse de Brinon pour célébrer la réussite de cette opération chirurgicale. En fait, il s'agissait d'un cantique en français écrit par celle-ci, de sorte que les orphelines de l'école de Saint-Cyr dont elle était supérieure puissent chanter lors de l'arrivée du roi rétabli8. Toutefois, en janvier 1687, lors d'une répétition de son propre Te Deum en latin, dans cette optique, Lully se blessa sérieusement au pied avec son bâton de direction et, ayant refusé l'amputation, mourra de la gangrène quelques semaines plus tard. "
"
Contrairement à ce que l'on diffusait, l'origine de plusieurs hymnes nationaux dont le dit God Save the Queen n'était pas le Domine, salvum fac regem9. L'histoire remonte une maladie grave du roi de France Louis XIV en 1686. À la suite de sa guérison, plusieurs Te Deum furent exécutés dans le royaume. Mais auprès de la Maison royale de Saint-Louis, les jeunes pensionnaires souhaitaient chanter leur propre cantique en français. D'où, Madame de Brinon, nièce de la fondatrice Madame de Maintenon, en écrivit un. C'était Jean-Baptiste Lully qui composa sa mélodie, juste avant le décès du ce musicien. Rappelons qu'à la suite de l'édit de Fontainebleau (1685), tous les chants liturgiques en français étaient interditsa 5. C'était une exception, avec les cantiques de Jean Racine, réservée à ces orphelines.
Puis en 1714, après la paix des traités d'Utrecht (1713), Georg Friedrich Haendel visita le château de Versailles. Cela peut expliquer pourquoi la première version de l'hymne britannique était issue de la mélodie de Lully.
Selon l'hypothèse, ce chant charma Haendel, qui avait passé sa jeunesse à Rome. Il copia et présenta cette pièce au nouveau roi George I er. S'il ne s'agit officiellement jamais de l'hymne national britannique, la version anglaise est toujours exécutée lors des cérémonies officielles9.
Alors que son origine était diffusée en France par une pique de la marquise de Créquy « Que l'hymne des Anglais naquit ... »9, à Londres elle restait, paradoxalement, obscure12. En effet, le sujet demeurait vraiment délicat pour Haendel. Le roi George fut accueilli comme prince protestant le plus proche de la feue reine Anne (selon l'Acte d'Établissement (1701) ; donc pas question, hymne issu du Domine catholique, mais ce texte français, dont le genre était interdit par Louis XIV, était convenable). De surcroît, quelle surprise pour Haendel, ce roi n'etait autre que son ancien patron à Hanovre. Et le compositeur ayant refusé d'y retourner cherchait maintenant la grâce de ce souverain. Sinon, il aurait dû quitter l'Angleterre. Encore y a-t-il une autre hypothèse. D'après les études de Christopher Hogwood, Haendel représentait, malgré son grand talent de composition et sa réputation, plusieurs œuvres méconnues sans mentionner leurs vrais compositeurs, ce qui restait incompréhensible même à Hogwood13. Dans ce cas, ce cantique français, qui était posthume (Lully) et non publié, était idéal ... à piller. En résumé, si Haendel peut être l'auteur de cet événement, il ne laissa aucune trace.
En outre, ce qui reste difficile, c'est qu'il ne reste aucun document officiel et sûr à Versailles ni à Saint-Cyr14. Outre-Manche non plus, personne ne réussit à identifier son origine jusqu'ici. "